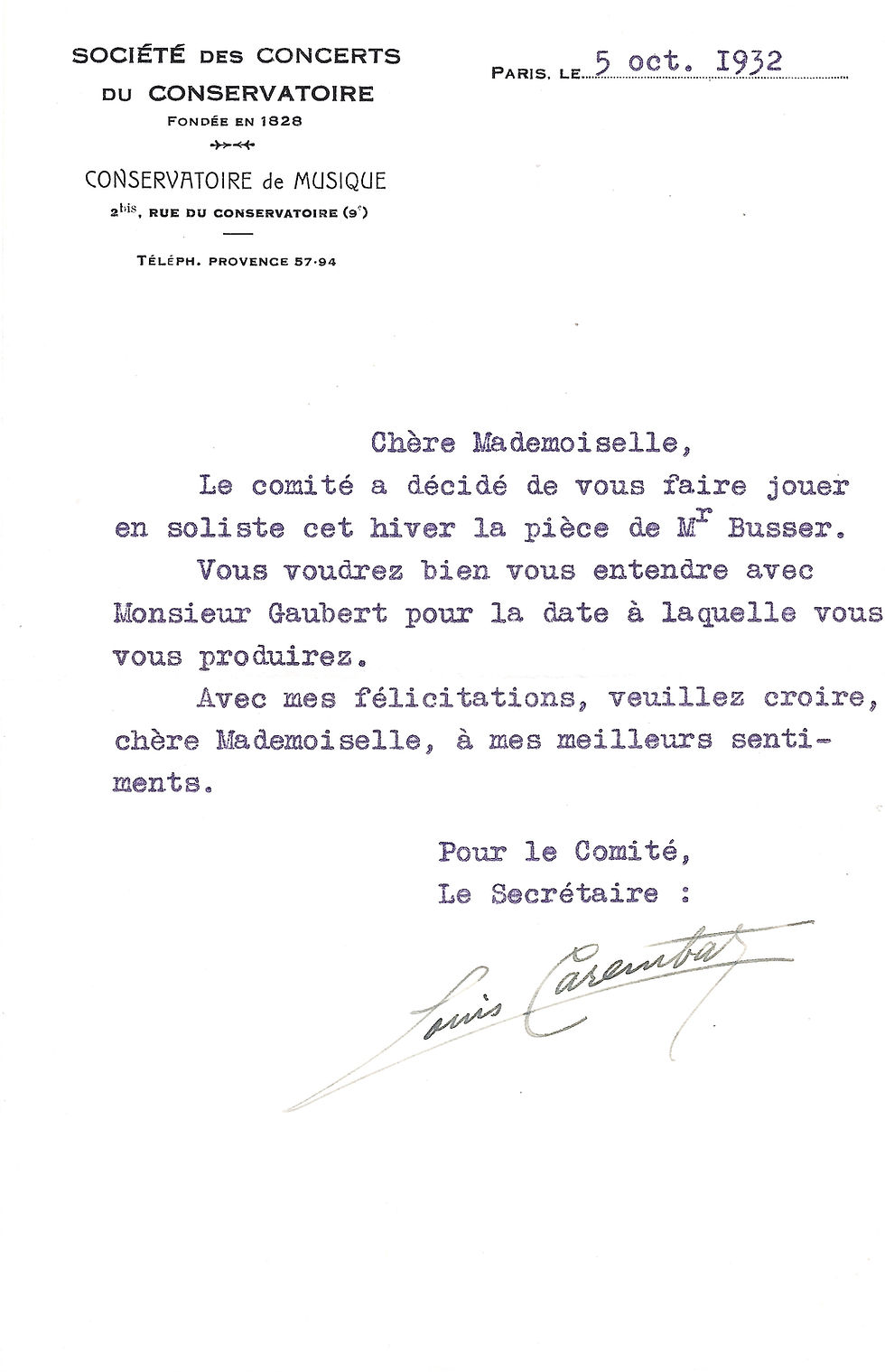Trio pour flûte, violoncelle et harpe d'André Jolivet
- AGENCE WAPITIX

- 12 févr. 2025
- 5 min de lecture
Dernière mise à jour : 18 févr. 2025
Trio pour flûte, violoncelle et harpe d'André Jolivet

André Jolivet (1905–1974)
Intégrale des œuvres pour flûte
André Jolivet est né à Paris en 1905, fils de deux artistes amateurs. Il n'est pas étonnant que, dans cet environnement, il ait appris à aimer toutes sortes de formes d'art dès son enfance. Il prend des cours de piano et de peinture et, après avoir assisté à sa première représentation à la Comédie-Française, commence également à écrire des poèmes et des pièces de théâtre, allant même jusqu'à mettre en musique certaines d'entre elles.
Alors qu'il n'est qu'un adolescent, Jolivet rencontre Paul Le Flem. Par la suite, il a commencé à étudier la composition avec lui et a trouvé sa vocation. Même si Jolivet venait d'un milieu artistique, ses parents ne soutenaient pas son souhait de poursuivre une carrière dans la musique. C'est ainsi que Jolivet commence des études à l'École normale d'instituteur et devient enseignant, ne composant que pendant son temps libre.
En 1929, Jolivet assiste à la première française d’Amériques d'Edgar Varèse, qui est une révélation. Présenté au compositeur par Le Flem, Jolivet devient alors le seul élève européen de Varèse. En 1934, Jolivet est contacté par Olivier Messiaen, qui entend son Quatuor à cordes et souhaite le rencontrer. Ils se lient d'amitié et, avec Daniel-Lesur, fondent une société de concerts de musique de chambre appelée La Spirale, dont le but est de promouvoir la musique contemporaine. Lorsqu'Yves Baudrier propose de financer des concerts symphoniques également pour promouvoir des œuvres contemporaines, tous les quatre transforment La Spirale en un nouveau groupe, appelé La Jeune France.
Ensemble, ils aspiraient à ramener des valeurs humaines et spirituelles à la musique, dans un monde qu'ils trouvaient de plus en plus indifférent et impersonnel. L'unité du groupe s'est effondrée lorsque la Seconde Guerre mondiale a éclaté en France. En 1942, une bourse de l'Association pour la diffusion de la pensée française permet à Jolivet d'arrêter d'enseigner et de se consacrer enfin entièrement à la musique.
C'est à partir de ce moment qu'il a assuré sa position dans la vie culturelle française et que son influence sur la culture française a commencé à grandir. En 1945, il est nommé directeur de la musique de la Comédie- Française, poste qu'il occupe jusqu'en 1959. Il devient ensuite conseiller du ministre français de la Culture, André Malraux, jusqu'en 1961.
En 1966, il est nommé professeur de composition au Conservatoire National Supérieur de Paris, ce qui est un exploit tout à fait remarquable, car lui-même n'a jamais étudié dans la prestigieuse institution. André Jolivet meurt en 1974, et à ce moment-là, sa musique et ses réalisations sont reconnues dans le monde entier. D'innombrables récompenses, prix et distinctions attestent de l'importance de son œuvre, dont la plus haute distinction française, la Légion d'honneur.
La musique d'André Jolivet
Comme il a beaucoup voyagé et qu'il s'est beaucoup intéressé à toutes les formes de spiritualité et de cultures, la musique de Jolivet montre des signes d'influences innombrables et très diverses. On pourrait citer Bartók, la musique africaine, balinaise et japonaise, ou bien sûr son mentor Varèse, et on ne commencerait même pas à efleurer la surface de ce qui aurait pu façonner les compositions de Jolivet. Son objectif était de « restaurer le sens ancien et original de la musique lorsqu'elle était l'expression magique et incantatoire du sacré dans les communautés humaines ». En tant que tel, sa musique ne tombe pas dans un style facilement identifiable. Ni dodécaphonique, ni vraiment atonale, parfois avec des couleurs modales claires mais jamais strictes, on pourrait dire que la musique de Jolivet est une catégorie à part, ayant souvent une qualité incantatoire. Dans le contexte de la vie musicale française du XXe siècle, André Jolivet, en tant que compositeur, jamais intéressé par l'écriture selon les tendances contemporaines et restant toujours fidèle à ses propres convictions, nous frappe comme un homme qui devait avoir une formidable force de caractère.
Petite suite pour flûte, alto et harpe (1941)
Cette œuvre a été composée à l'origine pour servir de musique de scène à la pièce Aimer sans savoir qui de Lope de Vega, mise en scène par Jean Vilar. Comme la pièce n'a jamais été jouée, la pièce a été créée en 1943 pour Radio Paris, et n'a été publiée qu'après la mort du compositeur. Jolivet lui-même a écrit quelques mots sur son œuvre, nous permettant d'imaginer l'action censée se dérouler sur scène :
« Le Prélude suit les rêveries d'une jeune femme sentimentale se balançant dans un hamac par une soirée de printemps enivrante. Le Modéré développe l'impression d'être à découvert donnée par le Prélude. Le Vif joint les rythmes espagnols aux doubles croches en fuite, imitant les poursuites ludiques d'un jeune couple amoureux. L' Allant déroule un dialogue tendre et exprime toute sa douce affection, tandis que le dernier mouvement, contrasté, expose le point de vue ironique et burlesque du valet de pied de la comédie traditionnelle, amusé par toutes ces affaires sentimentales.
Pastorales de Noël pour flûte, basson et harpe (1943)
Composée pour le trio Alys Lautemann, Jolivet a écrit cette pièce avec un objectif noble : il voulait que cette œuvre soit jouable par des musiciens amateurs, rendant ainsi le langage musical contemporain accessible à un public plus large. Contemplative, mystérieuse ou pleine d'une joie à peine contenue, cette œuvre développe toutes les atmosphères que l'on peut associer à Noël, sans jamais tomber dans un quelconque cliché.
Concerto pour flûte n° 1 pour flûte et orchestre à cordes (1949)
Écrit pour Jean-Pierre Rampal, ce premier Concerto pour flûte et orchestre à cordes comprend quatre mouvements. L'Andante cantabile ouvre la pièce avec sa ligne de flûte interminable et solitaire flottant au- dessus des accords des cordes. À mesure que la tension monte et que l'orchestre s'agite, l'angoisse du premier mouvement se transforme en un Allegro scherzando ludique. Il est écrit d'une manière qui ressemble plus à un dialogue, les lignes et les motifs de la flûte et de l'orchestre se complétant mutuellement. L'atmosphère du scherzando prend fin de manière abrupte et inattendue, laissant le public à bout de soufle et impatient d'entendre le troisième mouvement, le seul qui ne soit pas attacca. Le Largo joue le thème entendu pour la première fois dans le Concerto, cette fois avec toute la force de la section des cordes, s'effaçant pour laisser place à deux phrases interrogatives jouées par une flûte soudain très solitaire. Le dernier Allegro risoluto est l'un des morceaux les plus frénétiques que Jolivet ait écrits. Les parties de flûte et d'orchestre sont étroitement liées, ce qui rend le processus de répétition et de jeu plus proche de la musique de chambre que ce que l'on trouve normalement dans un concerto, avec toute la gamme de texture qu'un orchestre fournit. L'aspect profondément rythmé de ce mouvement, combiné à de nombreux motifs et répétitions de thèmes, donne un caractère incantatoire indubitable.
Sonatine pour flûte et clarinette (1961)
Le premier mouvement introduit une atmosphère très contemplative et rhapsodique. Sa structure en miroir laisse l'auditeur dans le même état d'esprit qu'il évoque au début : introspectif et émerveillé. Le deuxième mouvement a une sensation nettement plus rythmée. L'utilisation de dynamiques et d'articulations très contrastées donne à ce mouvement une couleur distincte de musique folklorique. La tension monte tout au long du mouvement, jusqu'à ce que le stringendo final le mette fin à une fin bourdonnante et frénétique.
Le finale de la Sonatine commence par une partie lente dans laquelle la flûte et la clarinette échangent une ligne ornementée semblable à une cadence, et une mélodie très lyrique et flottante. Cet Intermezzo laisse place à un Vivace qui utilise les mêmes moyens rythmiques et articulatoires que le deuxième mouvement, mais avec une qualité vocale plus importante. L'utilisation de toute la gamme du registre de l'instrument, qui s'élève à mesure que la pièce s'achève, et d'un cordendo, berce les musiciens et les auditeurs dans un état de transe jusqu'à l'unisson final surprenant et strident. À bien des égards, le traitement dynamique, rythmique et motivique de cette Sonatine n'est pas sans rappeler les Cinq Incantations pour flûte solo.
Alla rustica pour flûte et harpe (1963)
On ne peut manquer de penser à Bartók en entendant cette pièce pour la première fois, car elle rappelle de toute évidence la musique populaire. En effet, il a été composé des années plus tard, et basé sur une œuvre inédite intitulée Divertissement à la roumaine. Écrite en 1946 pour piccolo, cor anglais, violon et harpe, la version originale n'a jamais été incluse dans le catalogue du compositeur. Au lieu de cela, il l'a retravaillé dans ce duo pour flûte et harpe, à propos duquel il a écrit :
« Cette œuvre n'a d'autre ambition que de célébrer les qualités musicales et la volubilité de deux instruments qui se marient admirablement : la flûte traversière et la harpe. Les thèmes mélodiques sont proches des mélismes roumains autrefois écrits par Bartók. Ils sont développés de la manière la plus variable possible dans une écriture virtuose qui tire souvent sa plus grande intensité sonore de l'union de deux solistes par ailleurs assez réservés.
Une minute trente pour flûte et percussion (1972)
Cette œuvre a été découverte par Pierre-André Valade en 1992, alors qu'il effectuait des recherches avant l'enregistrement de l'intégrale des œuvres pour flûte de Jolivet. Comme il avait été laissé inachevé et sans titre, Valade lui donna le nom de sa durée, avec la permission de la fille du compositeur, Mme Christine Jolivet-Erlih.
Suite en concert pour flûte et quatre percussionnistes (1965)
Aussi connue sous le nom de Deuxième Concerto, cette pièce a été composée en raison d'une demande de Jean-Pierre Rampal – il avait joué la première tellement de fois qu'il avait exprimé le souhait d'en jouer une nouvelle. Jolivet a clairement été inspiré par le défi – c'est l'une des pièces les plus intéressantes de tout le répertoire de la flûte. Son choix d'instruments est délibéré – il chérissait à la fois la flûte et les percussions comme étant des instruments très proches des sens « primitifs » et de l'origine de la musique qu'il considérait comme essentielle. La pièce est très difficile à différents niveaux. Techniquement, il repousse les limites des instruments, mettant en valeur la connaissance inégalée de Jolivet de leurs capacités.
Rythmiquement, il a une structure complexe, complexe et inhabituelle. Musicalement, malgré les difficultés, les interprètes doivent façonner et phraser malgré la nature rythmique des instruments percussifs. Le fait que l'ensemble dégage un caractère primitif et induise une frénésie inéluctable chez l'auditeur malgré ces défis est une preuve irréfutable du génie musical de Jolivet.
Pipeaubec pour flûte et percussion (1972)
Cette pièce en deux courts mouvements a été composée à l'origine pour une flûte à bec. L'association de la flûte et des percussions, dans un cadre où l'absence d'instruments plus sophistiqués est notable, crée une atmosphère très particulière. Le sentiment pastoral du premier mouvement laisse place à un caractère plus rustique. Il s'agit d'une autre œuvre qui rappelle le côté incantatoire de la musique de Jolivet.
Hélène Boulègue